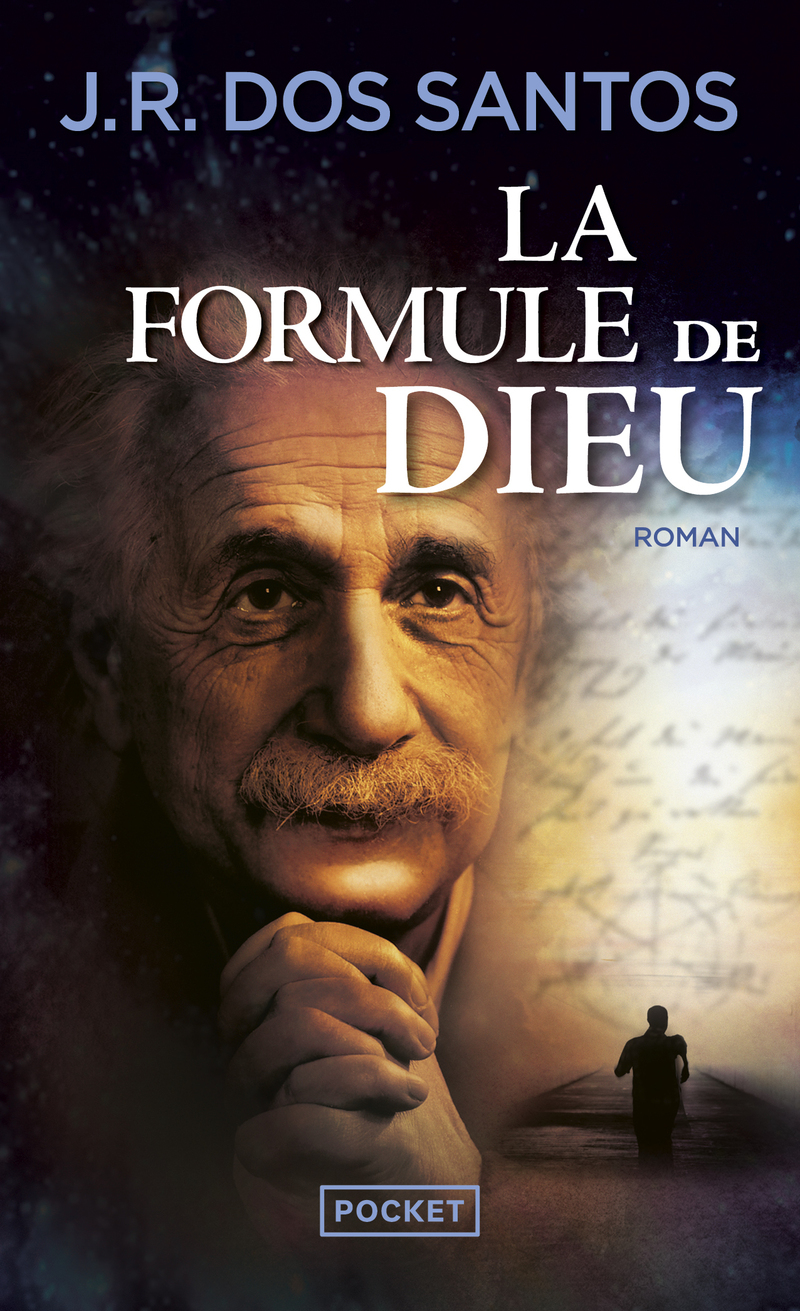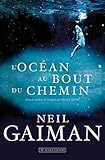Dans la famille Andersen, je demande le grand-père. Un type pas très causant parti de sa Norvège natale dans les années quarante. Est-ce qu’il a trouvé une vie meilleure en Amérique ? Pas vraiment, car il a ramené ses démons avec lui. Les fantômes du vieux pays comme il les appelle.
Dans la famille Andersen, je voudrais aussi la mère. Une fille un peu névrosée née dans le Midwest des années cinquante. Elle rêve de poésie et d’art, une gamine brillante qui dénote un peu au milieu de l’Amérique profonde. Un signe particulier ? Elle abandonne sa famille et disparait alors que son fils peine à rentrer dans l’adolescence.
Enfin dans la famille Andersen, je voudrais le fils. Samuel, notre narrateur principal. Pas vraiment un héro, plutôt le genre à rater sa vie. Il a failli trouver le grand amour, il a failli devenir un écrivain célèbre. Il aura surtout failli.
Samuel ne s’est probablement jamais remis de la disparition de sa mère à 11 ans. Alors quand celle-ci réapparait soudainement au début du roman en agressant publiquement le futur candidat aux élections présidentielles, notre narrateur essaie d’ignorer l’évènement. Malheureusement pour lui, les évènements vont le rattraper et lui forcer la main. Ils sont rancuniers les fantômes scandinaves.
Avec Les fantômes du vieux pays, Nathan Hill nous dresse une saga familiale avec ses secrets, ses traumatismes et ses mensonges. L’Amérique, ce nouveau pays apporte aussi son lot de fantômes pour compléter la toile de fond. Des manifestations étudiantes pour la fin de la guerre au Vietnam réprimées dans le sang à la crise financière des subprimes en passant par la guerre du Golfe ou les conséquences du 11 septembre, le roman étale un demi siècle de l’histoire des Etats Unis.
Le livre est divisé en dix chapitres. Chacun de plonge dans l’une des trois périodes clefs de l’histoire.
• Tout d’abord le temps ‘présent’, 2011. Le narrateur devenu adulte vit une situation professionnelle compliquée et l’agression du sénateur Packer le forcera à se plonger dans son histoire.
• En 1988, le narrateur ne le sait pas encore mais il vit sa dernière année avec sa mère. Il quitte l’enfance fait des rencontres qui le marqueront à vie.
• Il y a enfin l’année 1968, la mère du narrateur termine son année au lycée et s’apprête à partir pour Chicago et rentrer à l’université.
En dehors de la famille Andersen, on trouve des personnages forts et marquants. Difficile d’en dire plus sur l’intrique sans gâcher le plaisir du lecteur.
Pour un premier roman, je n’ose parler de chef d’œuvre. La postérité donnera son jugement bien plus tard. Par contre Nathan Hill nous a pondu un véritable page-turner comme on les appelle. Ce livre est comme un bol de cacahouètes, à chaque fois on en reprend ‘juste pour quelques pages’. Et puis soudain, le Nix saute au dessus de la falaise vers les flots déchainés et les rochers. Les 700 pages n’étaient plus que souvenirs me laissant avec un furieux sentiment de manque.
Ce livre aura très bien marché pour moi. Car à quelques mois près, j’ai l’âge du narrateur et de l’auteur. Dans le deuxième chapitre, j’ai retrouvé un peu du souffle de Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, un récit de l’enfance. Les références, notamment aux années quatre vingt ont baigné ma propre adolescence.
Pour conclure, je dois remercier les éditions Gallimard et Babelio qui m’ont donné l’occasion de découvrir une histoire captivante et ambitieuse ainsi qu’un nouvel auteur à suivre.
PS : Puisque la critique est facile, je vais essayer de cracher un peu de venin.
Même si j’ai beaucoup aimé ce livre, il y a quelques faiblesses qui ont parfois gâché mon plaisir. La plus grosse critique que je pourrais formuler concerne le caractère du narrateur et de sa mère. Ce sont les victimes des évènements et des agissements des autres personnages. Ils sont si peu acteurs de leurs propre vie que l’on en vient à se dire qu’ils méritent leurs malheurs. Cela se ressent le plus dans les dialogues. Les autres parlent et agissent, le narrateur écoute et subit.
La fin aussi est perfectible, l’auteur conclu toutes ses intrigues de manière assez scolaire. Un peu comme s’il s’agissait de terminer pour terminer. Quel dommage que le dernier point soit si final…