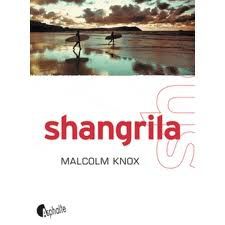L'oiseau chanteur a été trop curieux, il s'est posé ici et la toile ne le lâche plus.
Bienvenue sur ma branche . . .
samedi, mars 22, 2014
Au fond des caves des HLM on entend pourtant l'appel des Muezzins..
lundi, mars 04, 2013
Born in Trappes
Joie de recevoir un livre en échange d’une critique. Il n’empêche qu’avec cette lecture, me voilà muté en banlieues dans ces quartiers pudiquement dits difficiles.
En recevant « Made in Trappes » par Alain Degois, j’avoue que mes sentiments étaient partagés.
L’agacement tout d’abord, car il s’agit d’un livre de plus sur les banieues surmédiatisées. Un coup de projecteur brûlant de plus sur des saltimbanques ravis de se donner en spectacle.
Au final, la nostalgie l’a emporté. Trappes, j’y suis né. J’ai eu la chance de passer un quart de siècle à l’ombre de ses hlm, protégé des hordes barbares par les remparts de la commanderie des chevaliers du temple. J’ai ainsi passé ma jeunesse dans la cité plus cossue du comte de Maurepas.
J’imagine que d’ici quelques décennies, les historiens retiendront que les cités et la violence urbaine ont écrit l’histoire de France du vingt-et-unième siècle. J’éprouve un petit pincement au cœur d’avoir assisté en voisin aux premières heures du drame.
Trappes est donc tristement célèbre, pour ses trafics, pour sa violence, pour son prosélytisme religieux. On ne remerciera jamais autant les médias d’amplifier et de nourrir le phénomène. La bonne ville de Trappes est connue aussi pour ses célébrités. Anelka, Omar Sy, Shy’m, la liste des personnalités est longue comme le bras. Preuve s’il en est que les cités sont capables de produire autre chose que de la racaille.
Alain Degois, dit papy est ainsi connu pour avoir révélé au public le talent de Djamel Debbouze. Beaucoup d’autres ont eu la chance de passer de l’ombre à la lumière grâce à ses ateliers de théâtre. Véritable self- « made in Trappes »-man, Papy aura consacré sa vie à la ville. Alain Degois possède une bonne raison, et surtout une sacrée crédibilité pour écrire un livre et essayer de faire taire les clichés.
Dès l’introduction, le paysage est posé, sincère et authentique. Pas de tromperie sur la marchandise, l’auteur connait son affaire. Le reste narration est rythmée par une dizaine de chapitres, autant d’idées reçues sur la banlieue.
- Cliché numéro 1 : Les blancs qui vivent dans les cités votent Front national.
- Cliché numéro 2 : Pour résoudre le problème de la délinquance en banlieue, il faut construire plus de prisons
- Cliché numéro 3 : le boulot des policiers, ce n’est pas de jouer au basket avec les jeunes
- Cliché numéro 4 : L’Etat a mis beaucoup d’argent en banlieue et pourtant rien n’a changé. A quoi bon ?
- Cliché numéro 5 : En banlieue, on tague et on rappe
- Cliché numéro 6 : Les musulmans veulent islamiser notre pays (en passant par les banlieues)
- Cliché numéro 7 : Il faut être un beur de banlieue pour percer aujourd’hui au cinéma ou à la télévision
- Cliché numéro 8 : Le rêve de tous les habitants de la banlieue, n’est-ce pas de la quitter ?
On pourrait croire tenir entre ses mains un essai de sociologie optimiste et bien pensante. Et bien non, Papy n’est pas un universitaire qui étudie les mœurs des créatures étranges bien à l’abri derrière les grillages du zoo urbain. Il vit dans la ville, c’est un Trappiste pur sang.
Il ne possède certainement pas le recul ou le génie pour suggérer des solutions miracles. Ce livre se veut surtout un témoignage sur l’histoire et le destin d’une ville et de ses habitants.
De la ville campagnarde qui s’embourgeoisait à cultiver et à nourrir Paris, Trappes s’est transformée en ville ouvrière. Elle n’aura loupé un virage dans son destin de ville nouvelle. Après le rêve du pays de la tolérance et du melting-pot, le réveil est difficile pour les habitants de ce ghetto des communes environnantes.
Papy aura vécu cette mutation radicale, une illumination puissante pour son livre. Malheureusement pour moi, l’essai n’est pas transformé.
Là où l’on attend des idées nouvelles, on trouve surtout une autobiographie mâtinée d’orgueil. L’auteur se complait à contempler son passé plutôt qu’à regarder l’avenir.
Pour le coup, Papy enfonce quelques portes ouvertes et brode sur d’autres clichés. A dénoncer sans cesse l’administration Kafkaïenne et la machine politique, il donne le bâton pour se faire battre à ses détracteurs.
Si je devais résumer ce que j’ai compris du livre, les meilleures chances de la banlieue résident dans le courage et l’acharnement d’individus isolés.
Si je n’ai retenu qu’une leçon de mes cours d’histoire, c’est que dans ce nouveau millénaire désenchanté, le temps des héros est révolu...
Alain Degois a eu une vie passionnante, et vécu des temps intéressants mais difficiles. Il dresse un portrait fidèle de la banlieue. En plus l’ouvrage se lit facilement. En bref. Pour celles et ceux qui ne connaissent de la banlieue que l’image relayée par les mass media, ce livre est à lire avant de se faire recruter par la marine...
lundi, janvier 21, 2013
Sous le ciel de faïence ne brillent que les correspondances
On raconte qu’il n’y a pas de soleil sous la terre, que l’on croise des gars que l’on ne reconnait pas. Bienvenue parmi le Peuple des tunnels.
Astrid Fontaine nous guide dans les couloirs du souterrain pour remonter dans les années folles. Au travers des petites gens qui font la grande histoire, elle nous raconte l’histoire de la compagnie Nord-Sud. L’ère héroïque de la construction du métropolitain.
Il était une fois Goliath, j’ai nommé la Compagnie du chemin de fer Métropolitain de Paris (CMP) qui avait acquis une concession de la ville de Paris pour concevoir une ligne de transports en commun pour la ville.
L’histoire n’aura retenu qu’eux, et les travaux de l’ingénieur Fulgence Bienvenüe.
Mais face à eux se dressait David, la compagnie nord-Sud et l’ingénieur Jean-Baptiste Berlier. La société exploitait deux lignes de métro, notamment la célèbre Montmartre-Montparnasse. Elle a également traversé la Seine, exploit fameux de l’époque.
Cette fois-ci, David a perdu. La fronde aura vécu et la CMP absorbera sa petite sœur pour finalement se voir elle-même nationalisée et devenir la pachydermique Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP).
Il reste cependant des traces de la « Nord-Sud » qui s’offrent à l’œil exercé. Ces lettres NS entremêlée dans le fer forgé ou bien gravées sur la faïence ou encore la rotonde de la gare Saint-Lazare en sont les témoignages bien vivants.
En dehors de cela, pas grand-chose. L’histoire n’est qu’un char sans rétroviseurs. Il fallait bien les talents d’ethnologue d’Astrid Fontaine pour faire revivre la compagnie oubliée. Comment ? Au travers des paperasses soigneusement archivées par la RATP.
On trouve dans ces formulaires et ses matricules l’écho de la vie d’autrefois. Les courriers de retards, les dossiers médicaux, les lettres aux collègues et tant d’autres fragments d’histoires.
C’est l’approche de l’auteur, nous raconter l’histoire de la compagnie en recréant la vie de ses employés par leurs traces administratives.
On n’y trouve que des petites gens et bien des malheurs. Les années folles et insouciantes sont réservées à l’élite. Tandis que sous la terre, le peuple des tunnels souffre. On y parle de la misère et de la faim. Les hommes disparaissent à la guerre, les femmes meurent de l’enfantement. Tandis que l’alcoolisme, la syphilis ou la violence s’occupe des survivants. La comparaison avec l’Assommoir de Zola est flagrante. Sauf qu’il ne s’agit ici plus de fiction ni de roman.
Le livre se termine par une mise en perspective de l’histoire du métro à Paris. Comment cette audace technologique, ce projet fou a pu voir le jour et transformer radicalement la vie des parisiens. Metro-boulot-dodo ont une histoire et au fond des tunnels plus d’un siècle nous regarde.
dimanche, juin 10, 2012
Un oiseau dans la vague
dimanche, janvier 29, 2012
2011, le top du pire...
dimanche, janvier 01, 2012
La science fiction n’est pas morte

20h 12, l’heure de la fin du monde…
A l’heure où les plus fatigués se réveillent enfin. Avec une vilaine migraine en maudissant Sylvestre et sa fête trop arrosée. D’autres voient dans la fin de journée les prémisses d’un retour difficile à la vie active.
Il parait que si l’on résumait l’histoire de la terre à une année, l’ère des hommes ne tiendrait même pas sur une journée. D’ailleurs les mayas sont formels, à 20h 12 le réveil sonne et l’humanité disparait.
Nous voilà donc à la dernière minute avant l’apocalypse. Une minute de plus de trois cents jours, ça en laisse du temps pour célébrer ce cadeau précieux qu’on appelle la vie.
Eclatez-vous, profitez, vivez cette année comme la dernière. Car si le monde s’achève vous partirez sans regrets. Mais surtout, si nous sommes encore là le 31 décembre prochain vous pourrez affirmer que vous avez passé une très bonne année…
Et c’est bien tout ce que je vous souhaite !
Le truc aussi d’entamer une nouvelle année est de prendre des bonnes résolutions pour pouvoir les oublier quelques semaines plus tard. Alors, parmi les choses qu’il faudrait que je réussisse cette année :
- Partir moins tard du boulot
- Organiser correctement les vacances
- Reprendre le sport, mais de manière « régulière »
- Reprendre l’écriture (tiens par exemple, si je publiais ce billet sur mon blog)
- Dompter mes nerfs et prendre du recul sur mes angoisses et mes colères
Hop, voilà ces bonnes résolutions affichées en place publique. J’expose ainsi ma vie privée, mais surtout je construis le pilori pour me châtier si je ne les respecte pas.
lundi, août 15, 2011
Un oiseau sur les cendres et le sel de Sodome

samedi, juin 18, 2011
Triste bande dessinée pour un un photographe

- J'imaginais me cultiver sur l'époque sombre de la guerre civile espagnole.
- Je me faisais une joie de découvrir la vie et les images de Robert Capa, sacré plus grand photojournaliste de guerre.
- Je vibrais face au destin tragique du couple Capa & Taro.
lundi, mai 16, 2011
Il était une fois Neverwhere...
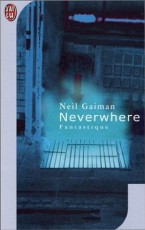 Cher monsieur Gaiman,
Cher monsieur Gaiman,J’ai bien peur que votre notoriété ne dresse comme un mur entre nous. Tous vos lecteurs, votre fan club, comme il est de bon ton de l’appeler, vous inonde de courriers, tous uniques et pourtant tous semblables.
Je crains que vous ne puissiez trouver le temps de lire cette lettre. Et pourtant, ma missive ne cherche qu’à vous mettre en garde.
Vous tripotez les mythes et les légendes depuis un petit bout de temps. Les jaloux iraient même jusqu’à prétendre que vous en avez fait votre fond de commerce.
Je ne fais pas partie des envieux et j’apprécie sincèrement votre travail, non, je vous écris aujourd’hui pour vous prévenir. Passe encore que l’on chatouille les barbes blanches des vieux décatis de l’Olympe, ils sont tellement sourds qu’ils n’entendent plus rien. Vous pouvez aussi broder sur les rêveurs éternels, ils sont toujours dans les nuages.
Par contre la mythologie urbaine, c’est du sérieux. A force de mettre en lumière les mythes qui souhaitaient rester dans l’ombre, ils en sont venus à vouloir se venger.
Vous avez réédité récemment Neverwhere, cette pittoresque chronique Londonienne. Et vous en avez fâché plus d’un. Un certain marquis, une connaissance commune, ne décolère pas depuis cet affront.
Résumons donc l’affaire. Avec votre plume si savoureuse, vous avez narré l’histoire de Richard Mayhew. Comment cet habitant terne de la ville moderne et polluée de Londres s’est par hasard retrouvé avec une jeune fille mourante dans les bras. Comment sa vie avait basculé. Devenu un fantôme parmi les vivants, il a été contraint de rejoindre le Londres-d-en-bas. Vous en avez profitez pour nous décrire cette terre de légende, invisible au commun des mortels et pourtant si bien entretenue par l’imaginaire collectif.
Vous ne nous avez rien épargné, le marché flottant, Knight bridge, le monastère des moines noirs et même l’Atlantide. Vous nous avez décrit les plus grandes personnalités qui règnent en maître dans ces domaines.
Votre livre est un véritable guide touristique et c’est bien là le fond du problème. Imaginez donc, les gens commencent à parler aux rats, certains guettent la créature sous les quais de métro ou encore attendent le wagon du compte.
Avec tout ça, nos amis ne peuvent être tranquilles. Il finira par y avoir des accidents. Je connais bien le marquis, j’imagine qu’il a trop parlé un soir de beuverie, que votre imagination a comblé les failles de son récit.
Si encore cela avait été mal écrit, mais non, le tout est raconté avec panache, humour et un sens aigu de la tragédie. Au final vous vous êtes fait pas mal d’ennemis, presque autant que de lecteurs.
Heureusement que vous avez mis tout un océan entre vous et votre ancienne patrie. Pour votre sécurité, c’est mieux ! Chasseur a une dent contre vous. Fort heureusement elle est coincée de ce côté de l’Atlantique par sa vilaine blessure à la hanche qui tarde à guérir.
J’ai oui dire que Dame Porte avait épousé en grandes noces ce freluquet soit disant guerrier le 29 avril de cette année 2011. Ils sont tout à leur bonheur et ne pensent pas à vous chercher querelle. Quand aux autres habitants de la Londres-d-en-bas, ils sont bien trop casaniers pour être réellement dangereux.
Mais faites bien attention à vous. Si jamais l’idée vous prend de revenir dans la perfide Albion, ne traînez pas seul tard le soir dans les ruelles désertes, évitez le métro et surtout, surtout, faites attention dans les quartiers trop anciens.
Je vous connais bien, j’ai lu votre bibliographie dans tous les sens. Je me fais bien du souci pour vous. Les mythes prennent également racine sous le soleil de Californie et ce n’est peut-être pas un hasard si vous résidez dans la cité des Angelins. Alors soyez prudent, il serait regrettable que notre époque fataliste et indifférente perde l’un de ses plus grands conteurs.
Bien à vous,
Un petit chaton qui a perdu ses bottes
jeudi, février 10, 2011
Non !
Une fois de plus, j’avais participé à la masse critique en laissant le hasard guider ma sélection. En découvrant dans le petit carton un exemplaire de Tout le monde vous dira non de Hubert Mansion, je me disais que parfois le hasard fait mal les choses. Décidément non, ce livre n’était pas fait pour moi. La faute en revient comme toujours à la quatrième de couverture, à ce petit bout de texte taillé pour décourager l’acheteur potentiel. Le publicitaire en manque d’inspiration prétendait attirer le pigeon en listant les recettes miracles pour réussir dans le monde impitoyable de la musique et du show business.
« There is no business like Show Business »
D’une part l’étendue de ma culture musicale se cantonne à la soupe servie à toute heure sur les radios pop fm pour meubler entre deux pages de pub. Et mes prétentions artistiques sont régulièrement démenties par les séances de torture que j’inflige à ma pauvre guitare. En bref, percer dans le domaine ne faisait pas partie de mes ambitions.
D’autre part, le genre de livres qui décrit comment faire pour réussir m’a toujours paru suspicieux. L’arnaque réussit surtout à enrichir les éditeurs en soulageant le porte monnaie des plus naïfs et des plus crédules.
Un semblant de conscience bénévolo-professionnelle m’a poussé à faire ma part de travail, à lire ce livre pour en faire une critique, fût-elle assassine.
Et puis j’ai lu, j’ai appris, j’ai compris. Notamment que je m’étais trompé sur ce livre. Nulle recette miracle pour faire fortune, la description juste d’un milieu ou les paillettes brillent trop fort.
Ami lecteur, soit prévenu avant d’ouvrir cet ouvrage. Abandonne tes dernières espérances romantiques. Le poète torturé est bel et bien maudit, mais par le poids du fisc et des vautours qui s’engraissent de son talent.
La rencontre entre l’art et l’argent a renvoyé muses sur le trottoir et les pauvres ont intérêt à enchainer les clients, à vider leurs bourses, quel que soit le sens que l’on donne à cette expression.
Car c’est le thème central de l’ouvrage, entre l’artiste et son public, il y a l’argent qui conditionne leurs rapports.
Un troisième invité que l’on cherche à engraisser, au détriment de l’Art.
Tout d’abord l’artiste, trop complexe, trop humain est simplifié par les promoteurs de son art pour en devenir sa propre caricature. Pour l’enfermer bien sagement dans sa petite case, facilement manipulable et vendable par les gourous du marketing.
Car le monde est trop vaste pour un petit chanteur qui n’a pour lui que la puissance modeste de ses cordes vocales. Pour le faire connaitre à son public, il faut qu’une assemblée d’hommes d’affaire grassouillets le cigare aux lèvres investissent un paquet de billets sans âme. Qui a parlé d’art? Non la musique est une chose sérieuse, un placement financier dont on doit calculer avec minutie le retour sur investissement.
Avec l’arrivée massive de ces flux d’argent, et on l’espère la gloire et le succès à la clef, il faut bétonner les contrats. S’il n’y avait pas déjà trop de monde à gérer la carrière de l’artiste, il faut y ajouter quelques avocats pour faire bonne mesure.
S’il existe une étincelle de talent ou d’opportunité rentable. Le manager, l’éditeur, la maison de disque, l’agent, les avocats sauront bien la faire prendre. Au moins pour illuminer la scène d’un feu de paille. Quand aux artistes, qui par définition échappent à ce monde pragmatique et capitaliste, ils ne peuvent pas comprendre. Entre la misère absolue, et la fortune trop vite faite, il ne semble pas y avoir d’intermédiaire. Les rares élus qui se rapprochent du soleil aveuglant de la gloire ne profitent que pour se brûler les ailes et finir endettés à vie sous les créanciers.
Au milieu de tout ça, le livre écrit par l’un de ses innombrables vampires du show business se lit très bien. Le texte est léger, parsemé d’anecdotes croustillantes et brosse une analyse décomplexée du milieu. J’ai appris beaucoup.
Quel dommage que l’on ne parle si peu de musique...
dimanche, janvier 09, 2011
Un oiseau sous la pluie

lundi, novembre 29, 2010
Un oiseau, une plume, une page immaculée et de l’encre qui pleure…
lundi, novembre 01, 2010
En attendant Godot
J’ai attendu, attendu. Il n’est finalement pas venu.
Lire une pièce c’est souvent ennuyeux. C’est encore pire si la pièce a été conçue expressément pour ça. Je ne ferais pas par contre pas attendre cette critique, elle est passée au dessus de moi, allée trop loin, je ne la rattraperais pas.
Un oiseau perdu
Du sang et du sexe pour vider une étagère trop remplie


vendredi, octobre 15, 2010
Un oiseau frigorifié…
lundi, août 23, 2010
800 pages plus tard, un crime ou un châtiment ?