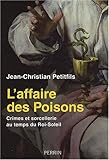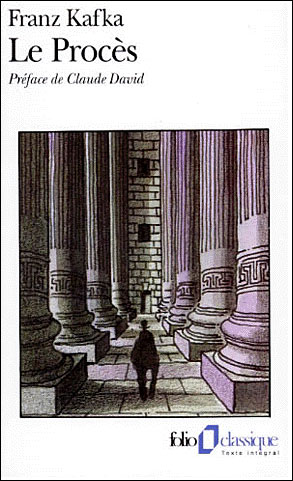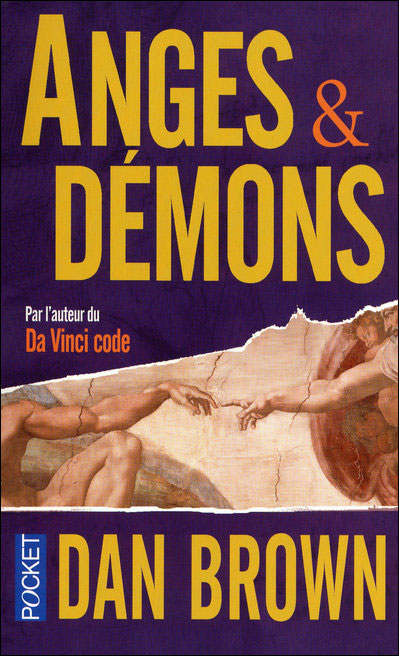[Avertissement] Attention, ce texte à reçu le label du Parti pour une Ecriture Durable et Environnementale (une écriture de PEDE pour les intimes). En conséquence de quoi, il est garanti sans smiley importé de l'autre bout de la toile, il n'a pas impliqué le travail de jeunes émoticônes asiatiques, ni d'autres symboles génétiquement modifiés pour clignoter ou briller la nuit au détriment de la consommation électrique. J'en appelle à la sagesse du lecteur averti (ça tombe bien on est toujours dans la section avertissement) pour identifier tout seul l'ironie, le second degré et parfois même l'humour qui peuvent parsemer le texte. D'autre part, des rumeurs persistantes font état d'une très large part d'autodérision dans les lignes qui vont suivre.
Attention, ce texte a été écrit initialement pour un forum de parapente, ceci explique mais n'excuse pas les termes et références au milieu. Vous voilà donc prévenus !
TOI !
Oui Toi, attiré par ce titre ronflant et prétentieux, attiré par la flamme du tragique comme un papillon de nuit. Toi qui n'a rien d'autre à faire pendant la journée que gâcher la confiance et l'argent de ton employeur. Oh, ça te concerne aussi petit malin, toi qui ne découvre ce message que le soir venu, n'as-tu pas une copine, une femme ou un poisson rouge dont il faudrait t'occuper avec amour et attention plutôt que de rester là, à lire les élucubrations numériques d'un camarade virtuel ?
Si tu es encore là, tu as déjà répondu à la première question, présentement tu n'as rien de mieux à faire que glander sur le net. Ca tombe bien, moi non plus.
Te voilà donc ici pour partager une expérience hors du commun. Tu as bien fait de rester. Tu t'apprêtes à découvrir au travers de ce récit quelque chose qu'à ma connaissance aucun parapentiste n'a jamais fait. J'ai repoussé les limites du possible vers des horizons nouveaux et fantastiques.
Il y a dans le domaine du parapente un bizutage assez fréquent qui veut que l'apprenti volant se sente obligé d'imposer à un public blasé le récit de son premier grand vol. Pour la peine, il aligne les superlatifs, les "extraordinaire" et autres "moment magique" de "liberté absolue" de "se sentir voler comme un oiseau".
Hey gars, t'as atterri, c'est bon ?
Alors remet les pieds sur terre. Tu t'es juste retrouvé en sac à patate confortablement installé sur une chaise longue suspendue à des ficelles. Avec un gus à la radio qui te disait quand tirer la ficelle gauche et quand tirer la ficelle droite. Pas de quoi en faire un roman non plus.
Il y en a qui continuent après de raconter leurs petites histoires et leurs vols. C'est le plus souvent présenté comme des récits "pour partager" (rendre jaloux, ouais) ou alors "pour apprendre aux autres" (à traduire par "se la péter") ou encore "pour garder une trace" (pas dans le fond du slip, ces prétentieux prétendent marquer la mémoire collective avec leur "cross" de quinze bornes le long des crêtes à mouettes). En bref, désolé pour les filles (surtout pour celles qui s'adonnent à l'exercice) mais c'est surtout un moyen de voir qui à la plus longue (il y en a même qui prétendent en avoir une de plus de 400 bornes ou capables de faire 281 fois le tour du slip).
On en trouve, parmi les plus atteints, des qui s'essaient à l'humour en narrant leur frustrations de vol de courte durée et leur changements de matériels dans des récits aussi pathétiques qu'inintéressants.
Et puis il y a ces autres histoires, beaucoup moins drôles. Les histoires de ceux pour qui le parapente s'arrête provisoirement ou définitivement suite à l'accident. Ceux qui terminent leurs derniers cross ou leur dernier tour de SAT en y laissant leurs jambes quand ils ne finissent pas six pieds sous terre parmi les taupes que nous avons tous côtoyé une paire de fois. Je ne commenterais pas ces récits, car ils ne me font pas rire et j'ai tendance à les éviter.
Pour en revenir à quelque chose de plus léger, je disais qu'au travers de ce récit vous allez découvrir quelque chose qu'à ma connaissance aucun parapentiste n'a jamais tenté. On trouve donc plein de récits de premières fois, de vols, ou de ces derniers vols se terminant dans des circonstances tragiques. Et bien je vais également vous raconter mon dernier vol. Malgré une paire de péripéties et un final pour lequel j'éprouve une certaine honte, il ne m'est rien arrivé de fâcheux. Je pense que c'est une première. Je soupçonne les autres ayants arrêté l'activité de s'être désintéressés du vol libre en général. Ce n'est pas mon cas, et je continue moi aussi à gâcher l'argent de mon employeur en passant bien trop d'heures de bureau à lire les péripéties de mes camarades volants. Surtout que ce printemps est pour le moins riche.
Il parait qu'il ne faut jamais dire jamais, mais ce texte tient aussi lieu d'épitaphe dans ma vie de parapentiste. Voilà mon dernier vol avant la nuit...
Et pour donner dans le côté symbolique et marquant, j'ai volé le dernier jour de validité de ma licence soit le 31 décembre 2009. La fin d'une année, la fin d'un monde, le tout dans un autre hémisphère, au milieu de l'océan indien.
Ce n'était pas une si grande nouveauté pour moi, j'avais déjà volé à la Réunion. A l'époque, jeune volant tout fraichement émoulu d'une vingtaine de ploufs, j'en avais rajouté deux à mon carnet de vol, sous le soleil de l'ile Bourbon, émerveillé par le survol d'un lagon turquoise, le spectacle des tortues et la magie de poser sur la plage.
Il faut que je fasse un mini point pour tous les pauvres qui n'ont pas l'opportunité de saloper l'atmosphère avec des vols longs courrier pour saccager des destinations exotiques. D'ailleurs, je me suis toujours demandé comment ils pouvaient investir dans du matos fiables pour se jeter dans le trou ces pauvres sans être contraints de manger des pâtes pour le restant de leurs jours, ce à quoi on m'a répondu qu'il y avait un rapport de cause à conséquence. Le corollaire serait qu'en tout mangeur de pâte il y a un parapentiste qui sommeille ?
Oups je m'égare, donc un bref topo sur le vol sur l'ile de la Réunion. Comme son nom l'indique il s'agit effectivement d'une ile pour les trois du fond qui suivent. En gros c'est une montagne posé en plein milieu de nulle part sur l'eau.
Vu que le vent dominent se ballade toujours dans le même sens, il y a un côté exposé au vent où en gros il pleut tout le temps. Et un côté sous le vent ou en gros il fait beau tout le temps.
On vole donc sous le vent, dit comme ça, ça pique un peu au début, mais on le vit très bien. Surtout que le reste de l'ile protège pas mal dudit vent dominant.
Dernière particularité, c'est que le temps se couvre assez vite dans les hauteurs, les journées débutent souvent sans un nuage tandis qu'à midi il pleut sur les hauts.
Donc pour voler là bas, c'est conseillé de voler tôt. C'est encore pire si tu veux décoller de haut. Il faut carrément investir dans un réveil avec une alarme musclée. Ben oui, parce qu'en tant que touriste, tu fais la fête tous les soirs, et comme tu veux goûter les spécialités locales à base de canne-à-sucre tu finis dans un état second (voire troisième). Et encore, j'ai pas parlé du Zamal (mais pour le coup, je n'en aurais pas tâté).
Tout est que me concernant, le réveil j'ai eu du mal à l'entendre. Et que donc, jour après jour, je me disais trop tard pour voler, j'essaierais demain.
Pour le dernier jour sur place, le 31 décembre, j'ai réussi à me lever mais j'étais de corvée shopping au marché créole. Joies de la vie de couple,me voilà perdu au milieu d'un marché pas aux odeurs étranges plutôt que de profiter des premiers thermiques. Argh, j'ai eu beau presser l'affaire on a terminé seulement à 11h. Qu'à cela ne tienne, c'était la dernière occasion où jamais. Et puis je l'avais tellement fantasmé ce vol. Accessoirement j'avais tellement galéré pour convaincre ma moitié de l'opportunité de sacrifier notre quota de bagage pour emmener ma voile.
Donc je suis allé voir, aux Colimaçons (le spot facile pour voler là-bas, pas forcément le plus beau, il est normalement suffisament bas pour permettre de voler toute la journée). Avant de monter, le plafond baissait petit à petit mais ça volait encore, youpeeee...
C'est parti, je ne me souvenais plus que la navette était aussi longue. Pendant ce temps là tous les parapentistes finissaient par se poser. Plus inquiétant encore, je n'en voyais pas d'autres repartir. Et pour cause, arrivé sur place, les barbules grises se baladaient tout juste une dizaine de mètres au dessus de la tête. Mais bon, vent pas trop de travers, assez soutenu mais régulier, pas de moutons sur la mer (on m'a dit qu'à la Réunion, fallait pas voler quand il y avait des moutons sur la mer, chais pas pourquoi, peut être que les parapentistes réunionnais sont allergiques aux kébabs).

Une fois tout déballé, le vent s'était bien renforcé et carrément orienté sud, donc plein travers. Ouuups! J'ai définitivement oublié la petite voix qui me disait, "Tibô, c'est pas très raisonnable ce que tu fait" car la deuxième petite voix me disait "Allez Tibô, c'est pas pire que sur les sites de soaring comme à la dune ou à Allevard, t'as déjà volé avec plus de vent, et puis en plus il est tout laminaire, facile non ? Et puis tu vas pas repartir avec des regrets".
Histoire d'évaluer la situation, je fais un peu de gonflage. C'est pas évident en travers de la pente, mais ça peut le faire. Première erreur, je n'étais pas, mais absolument pas sur un site à soaring, pas assez de pente.
Je m'élance et je me mange une grosse fermeture au moment de réorienter la voile dans la pente (oui, c'est définitivement travers). Qu'à cela ne tienne, je vais donc décoller de travers mais face au vent. Deuxième erreur.
Donc en quelques pas ça décolle, yesssss !

Mais bon, il y a du vent quand même. Et la Mojo, c'est pas la Faïal. Ca a un côté tracteur assez prononcé. Ca pardonne tout, ça bouge pas, mais dieu que c'est lent.
En l'occurrence je peux affirmer qu'il y avait entre 25 et 35 km/h de vent. Suffisamment pour scotcher net une Mojo(voir même la faire reculer par moment).
Par contre il n'y avait pas assez de vent et/ou de pente pour tenir en dynamique.
Du coup j'avançais à la vitesse d'un escargot neurasthénique et à une hauteur d'une poignée de mètres (c'est quand même très rare les escargots volants, il faut le souligner).
Mais de pente après le déco, il n'y en avait guère plus, ce n'était qu'un immense champ de canne à sucre. Fort heureusement pour moi, ce n'était que des jeunes plans sous mes pieds.
Parano et peureux, je maintenais aussi une bonne présence aux freins. Surtout qu'il y avait de-ci delà des bullettes assez costauds (enfin pas suffisamment pour me permettre de prendre véritablement de la hauteur).
Comme ça j'arrivais à la fin du champ de canne à sucre, en me disant que définitivement, c'est beaucoup mieux une fois distillé en bouteille, pi avec un peu de menthe, de citron vert, de limonade et beaucoup de glace. J'avais gagné approximativement une altitude relative de trois mètres. Le hic c'est qu'en contrebas du champ, il y avait une bonne rangée d'arbres. Exactement le genre à faire trois/quatre mètres de haut.
Option 1, je relâche les freins, j'accélère un poil et j'essaie de passer en force.
Mauvaise idée, soit ça ne passait pas et je me trouve sous le vent (un vent quand même bien soutenu, le lecteur attentif l'aura remarqué). Soit ça passait trop juste et je me retrouve perché en haut des arbres. Pas pratique pour redécoller. Soit avec un peu de chance ça passait, mais vu qu'il n'y avait toujours pas beaucoup de pente, je risquais de me retrouver à poser dans un endroit absolument pas fréquentable. J'ai déjà posé dans le Manival, tester l'atterrissage dans les ravines Réunionnaises ne me tentait pas vraiment.
Du coup, j'ai pris l'option 2 je me suis posé délicatement (en faisant du surplace c'est facile) entre deux rangées de canne à sucre, sans saccager le champ.
Et j'ai donc remonté la pente. C'est fou comme dans l'autre sens, elle parait plus raide. Le 31 décembre à la réunion, c'est la saison chaude et humide, il devait faire dans les 35°, il y avait bien 200% d'humidité dans l'air. Avec ma voile en bouchon sur l'épaule, en jean. Le bonheur.
Quelques litres de sueur plus tard, je termine ma montée dans le brouillard, visiblement le nuage avait continué de descendre pendant que je faisais mumuse en quasi statique au dessus du champ. Au cas où, je ré-étale mon matos, je profite des rares moments ou le nuage daignait remonter un brin pour gonfler et vérifier ma voile. Infatigable la tite mojo, toujours parfaite.
Le vent continuait à ronfler et je n'ai pas réussi à retrouver de nouveau créneau avec plus d'une minute de visibilité sur la mer. C'est donc très désappointé et un peu amer que j'ai tout replié. C'était probablement mieux ainsi.
Pour mon dernier vol, je n'aurais pas survolé ni lagon ni tortues, j'aurais juste profité encore 5 minutes "extraordinaires" de ce "moment magique" de "liberté absolue" de "se sentir voler comme un oiseau".
Enfin bon, je me suis bien rattrapé quelques heures plus tard sur la canne à sucre, en bouteille cette fois. Et puis c'était le réveillon. Petite dédicace pour ceux qui affectionnent les ballons brésiliens lors de la coupe Icare. Une fiesta sur la plage de St Gilles, dans son genre c'est aussi un "moment magique". Ca vole aussi mais c'est beaucoup plus calme.

Maintenant que j'ai écarté les curieux avec ce récit pataud, je peux en venir aux choses sérieuses et passablement polémiques. Avec le recul, je vais essayer d'analyser pourquoi j'ai arrêté le parapente. Les vraies bonnes raisons, les psychoses et tout ça.
Aller hop, je vais redemander un Dédé un ballon de rouge et vous expliquer ma vision du monde et faire un peu de psychologie de comptoir. Ca tombe bien j'y connais rien (s'il fallait s'y connaître pour parler de quelque chose, qu'est ce qu'on s'emmerderait).
Si on remet les choses à leurs justes valeurs, je n'ai qu'une seule raison qui ma poussé à arrêter l'activité. C'est tout bêtement la disparition du plaisir que je prenais à voler. Tant que l'activité reste un loisir et non un travail, le plaisir doit en rester le moteur prépondérant.
Le plaisir peut être immédiat, comme avec une tartine de nutella, faire coucou aux randonneurs vus d'en haut, profiter d'une vue somptueuse habituellement réservée aux oiseaux, envoyer un bon troicisse...
Le plaisir peut aussi être projeté, et c'est parfois tout aussi bon d'imaginer le bonheur qu'on va retirer d'une activité, comme lorsque je ressors de la FNAC avec un sac plein et un compte en banque vide, que je furetais sur le net à regarder les sites météo pour déterminer la journée et le site qui allaient le faire, lorsqu'on se serrait à 4,5, 6 ou sept et autant de parapentes dans une pauvre petite voiture pour monter au déco...
En l'occurrence, de ces deux aspects du plaisir, il ne me reste que les ruines d'une splendeur passée. Le bel édifice anéanti par la peur et la frustration, comme autant de catastrophes naturelles pour la confiance en soi.
Avec le recul que j'ai depuis près de six mois, je vais essayer de remonter le temps pour analyser mes derniers vols. Pas grand-chose à dire du dernier vol à la Réunion relaté au dessus. Je n'aurais pas du essayer j'ai été gentiment puni par ce loisir "qui pardonne si souvent".
C'est véritablement avec le vol précédent que ma décision est venue. J'ai passé bien des nuits à la mûrir au point que cela m'empêchait de dormir.
La goutte d'eau qui m'a plongé dans cette introspection insomniaque c'est mon avant dernier vol, vers midi, à Allevard.
J'en ai déjà parlé, mais juste pour resituer le contexte. Ce jour là, j'étais pas bien dans mes baskets (comme pour la plupart de mes vols précédents). Au déco, ça semblait vouloir commencer à tenir. Mon objectif était simplement de plouffer, donc pas trop de pression. Mais en l'air, sortie de déco, c'était malsain, bizarre, un peu chahuté. Pas pire, mais suffisamment pour me donner envie d'écourter mon vol (comme tant d'autres fois auparavant). J'arrive au dessus de la ville sans encombre, mais là une nouvelle séance de break-dance avec ma voile qui part dans tous les sens. Je suis super tendu, méga stressé, mais je gère à peu près le truc. Ca se calme une poignée de secondes (il faut entendre : ça bouge "un peu" moins).
Et là c'est le drame, outre les tremblements incontrôlés, je ne sens plus mes bras. Enfin je sens surtout une sensation comme les fourmillements, mais en puissance mille. Je n'ai plus aucune sensation tactile de la pression de la voile dans mes mains.
Flippant et surtout compliqué pour piloter, non ? Je ne me vois pas du tout construire mon approche au dessus de la digue dans ces conditions. C'est alors que dans le mépris le plus absolu des règles locales je vais survoler le lac (à ma décharge, j'avais encore pas mal de gaz). Bingo c'est effectivement plus calme. Mais le hic c'est que j'ai beau faire, je n'arrive pas à chasser ces maudites fourmis qui ont envahi mes bras.
Je finirais par aller me poser de l'autre côté du lac, un peu plus venté mais nettement moins turbulent. Et c'est bien dix minutes après l'atterrissage que je reprendrais mes sensations dans les mains et dans les bras.
La seule conclusion à laquelle j'ai pu arriver de ce phénomène c'est que sous l'effet de la crispation assez violente pendant les moments ou ça bougeait, j'ai du perturber les nerfs qui allaient bien pour contrôler ses avants bras.
J'ai tiré deux analyses de cette expérience. La première, c'est que je ne me sens plus bien quand je pars voler, la deuxième c'est que le stress a des vraies répercussions physiques qui me mettent en danger. En l'air je n'arrivais même plus à retirer mes mains des dragonnes, je ne serais certainement pas arrivé à trouver la poignée de mon secours, encore moins à gérer un vrac.
Je pense pouvoir remonter à l'origine de ce mal être, il se trouve quelques vols plus tôt, toujours à Allevard. Décidément, plus j'y pense, plus je me dis que ce site n'est pas sain. A l'époque j'avais un peu (pas beaucoup) plus de moral et un peu plus la niak. Un léger sud annoncé, je profite des bontés de l'école locale pour m'emmener au déco sud. Une poignée d'élèves avec des niveaux très différents me tiennent compagnie.
Sur place, l'école envoie rapidement ses stagiaires. C'est que le vent se renforce petit à petit et que ça commence à thermiquer sévère. Petite ambition pour ce vol, tourner un peu en local pour reprendre confiance, essayer de monter un peu et objectif d'essayer de monter aux Plagnes pour faire un petit touch-and-go. J'entends des gus à la radio qui ont eu la même idée, c'est donc que ça le fait. Pendant c temps là, j'attends que tous les élèves aient décollé avant de m'installer.
Quand je pars, ça c'est bien renforcé et il y a de sacrées bouffes. Impeccable pour décoller sans efforts.
En l'air changement d'atmosphère, ça bouge vraiment beaucoup. Des petites bullettes pas exploitables mais violentes qui explosent la voile. Le seul élève qui soit resté en l'air se fait littéralement démonter, sa voile fait tout comme on apprend dans les SIV, en avant, en arrière, façon montagne russe. Je suis impressionné, malgré le manque de contrôle, ça ne ferme pas.
C'est impressionnant mais pour l'instant ça va, je me maintiens. Jusqu'à ce que je rencontre une pure saloperie. Pas le temps de comprendre, j'avais l'impression que ça arrachait ma voile quand d'un coup plus rien dans les mains. Je me sens basculer en arrière. J'ai le temps de regarder en haut pour voir que ma voile ne s'y trouve plus, qu'elle est partie faire un petit tour en chiffon pour rentrer dans le sac.
Le temps semble comme figé, j'hésite, je ne comprends pas. Décro en entrée d'un truc velu ? Frontale massive ? Je sais pas, pourtant je n'avais pas trop de freins.
Tant pis il va falloir faire quelque chose, je vais essayer de temporiser. Trop tard, c'est parti trop loin, trop fort, trop devant. Je suis à la rue et pas symétrique. C'est donc fort justement parti pour une asymétrique dans les dents. Très gérable par contre, pas violent malgré le rappel pendulaire et pas de départ en rotation à déplorer (ou alors mon agripage du faisceau d'élévateur côté ouvert s'est révélé salutaire). Par contre c'est impressionnant de voir le truc se passer vu que j'avais la voile en face à ce moment là.
Passé cette sueur froide cassos en direction de la vallée. Ou c'était fort heureusement beaucoup plus calme (+1 en continu, tout doux, j'ai même hésité à aller faire du saute-mouton par-dessus Brame Farine pour poser chez moi).
Clairement, c'était ma plus mauvaise expérience de vol. Encore aujourd'hui à rédiger ce récit je sens cette boule au ventre, même si les détails sont flous, j'ai gardé intacte cette sensation de tomber, d'être au milieu du vide à prendre rendez-vous avec la faucheuse.
Avant ce vol malheureux qui a définitivement anéanti les reliquats de confiance en soi qui pouvait me rester. J'ai vécu pendant longtemps une sensation bizarre. Beaucoup trop de boulot, beaucoup de trucs perso m'arrivaient, pas le temps de
Sortir ma voile. Je volais seulement une fois par mois, pour "un vol de reprise" et pendant longtemps, j'avais cette première phase avant le vol d'angoisse. Un vol plus ou moins écourté par des conditions plus ou moins difficiles. Et à chaque fois à l'attéro j'avais cette rage de voler, qui me reprenait. Les dents qui recommençaient à pousser, l'envie folle de me battre contre les thermiques et leurs montrer qui était le patron. Mais malheureusement à chaque fois j'avais "pas le temps", "d'ailleurs je suis grave à la bourre", mais "demain j'y retourne", "la semaine prochaine c'est sûr".
Et puis un mois se passait avant que je ne ressorte ma voile.
Puis petit à petit ce sentiment euphorique post-vol a disparu, remplacé par un "posé vivant, posé content". La frustration et la jalousie par rapport aux camarades volants s'est ramenée aussi, ancrant fermement un sentiment de dégoût de soi et de cette saloperie de trouille.
Et puis finalement, quand j'ai eu de nouveau un peu le temps, je n'avais plus envie de voler. "Si c'est pour faire un plouf de 5 minutes et me faire peur, à quoi bon ?". Je me suis acharné un peu à me forcer à sortir en espérant que l'envie revienne, elle n'est jamais revenue. Au contraire je me suis fait encore plus peur (cf. les deux récits précédents).
Ce que je pense maintenant, après six mois cloué au sol.
Je continue à lire et à vivre par procuration les exploits de mes camarades volants mais je n'éprouve plus ce pincement au cœur de jalousie, voler me manque énormément, mais je n'ai aucune envie de reprendre ma licence.
En fait, je n'ai peut être pas trouvé dans le parapente ce que j'y cherchais. Vol libre à ce que l'on dit, il ne l'est pas vraiment. Ce n'est finalement pas le parapentiste qui décide de son itinéraire dans les cieux, il ne fait que grappiller des cheminements compliqués dans les miettes de ce que la météo et l'orientation des reliefs lui permettent.
En outre, ma trouille même si elle relève de l'irrationnel et du subjectif, elle a quand même des justifications profondes. Malgré tous les discours rassurant que j'ai longtemps moi-même colporté, le parapente reste un sport risqué ET dangereux. J'ai longtemps pensé que l'on maitrisait un peu le risque. Au final oui on pourrait le gérer mais non on ne le fait pas. Honnêtement, on se lasse des ploufs le matin sur site archi connu alors qu'il n'y a pas de vent météo, ni de nuages dans le ciel.
Au contraire, le parapentiste moyen cherche les conditions musclées et les turbulences, seul espoir de faire durer le vol. Et parmi ces parapentistes qui pensent avoir de l'expérience, qui pensent maitriser l'aérologie, combien ne se sont pas fait surprendre? Honnêtement, je n'en connais pas.
Et sans parler de surprise, combien d'entre nous ne prend pas de risques inconsidérés en toute connaissance de cause, à aller chercher les thermiques sous le vent, à frotter le caillou, à oublier les priorités dans la grappe, à accélérer dans les turbulences, à griller volontairement toutes ses marges ?
L'activité favorite du volant moyen en bande qui attend dans l'herbe "que les conditions s'installent" est de critiquer ceux qui décollent. Et très souvent la phrase revient, toujours la même "il a eu de la chance celui-là, il à du bol que le parapente pardonne". Je repose encore la question, qui parmi nous n'a pas bénéficié de cette chance proverbiale de temps en temps ? Qui n'a pas "grillé un jocker" ?
Il parait qu'il faut prendre des risques pour se sentir vivant. Je suis assez d'accord. Autant le gars qui saute une barre de 10 mètres à ski, qui descend un couloir de 60°, qui se tente l'Eiger a une évaluation directe de l'engagement. Autant le parapentiste ne l'a pas.
Je ne préfère pas parler du côté danger. Le bon sens paysan veut que rester suspendu avec des centaines voir des milliers de mètres de vide sous les pieds n'est pas forcément très bon pour la santé. Si la rupture inopinée du matériel est plutôt rare, une bonne cravate reste un bon moyen de trancher du tissu. La plupart des parapentes ne sont pas conçus pour sortir tout seul d'une autorotation si le pilote à un malaise. En cas de twist sérieux, il vaut mieux prier pour que le secours ait été correctement plié. Et puis le problème avec un contact violent avec la planète c'est qu'il y a souvent des cailloux tranchants qui trainent surtout dans les endroits fréquentés par nous autres.
En attendant bon vols à vous. C'est un sport passionnant que le vôtre. Continuer à faire rêver les terriens comme moi. Pour ma part, je vais en rester au macramé.