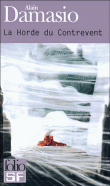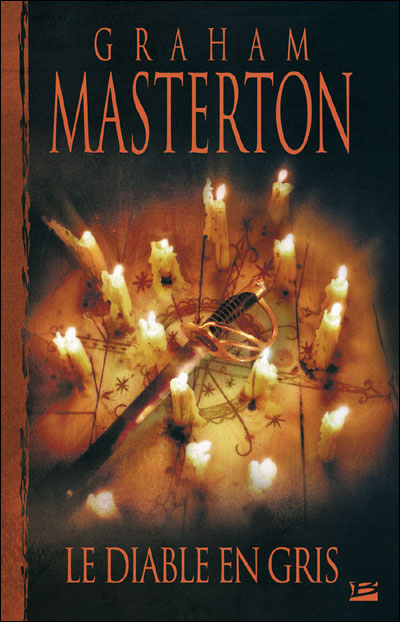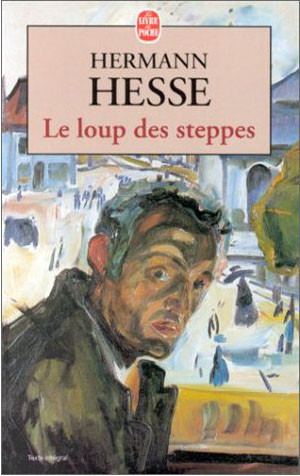Une revue de lecture copieuse ce mois ci. Je n'ai pas plus lu que d'habitude mais je souhaitais corriger un oubli. En effet, je n'avais pas encore parlé de
tandis que j'agonise, le titre aurait du m'inciter à la méfiance. Je me suis presque mort d'ennui avec ce premier roman que je m'apprête à critiquer. Le souvenir pénible de la lecture s'est faufilé dans les rayonnages obscurs de ma mémoire, pour sombrer tranquillement dans l'oubli. Mais peine perdue, je l'ai retrouvé ce petit souvenir mesquin. Après avoir tant souffert à la lecture, je suis bien obligé de l'étaler. C'est une sorte d'exorcisme.
Revenons-en au livre, enfin d'abord à l'auteur,
William Faulkner. Outre le fait d'avoir un nom assez évocateur, il fait partie du petit cénacle des prix nobels. Gage de qualité trompeur qui dissimule souvent les autels sanglants d'une idolâtrie snobinarde. Le personnage est également connu pour être le plus grand écrivain du sud des états unis (dixit la quatrième de couverture, vive les éditions
folio), son penchant pour l'éthanol sous ses formes liquide ou pour son talent de scénariste. Enfin bref, ce n'est pas pour cela que je cherchais à lire du
Faulkner, c'est surtout car le quidam a fondé sa réputation littéraire sur la création d'un compté imaginaire dans le Mississipi qui sert de décor à la plupart de ses écrits.
La description de la misère du siècle passé dans le Mississipi rural, voilà ce qui m'attirait chez
Faulkner. J'espérais trouver une intéressante documentation pour mon propre travail d'écriture, dont l'action se déroule également dans les états américains du sud. Je cherchais le chef d'œuvre du romancier,
Absalon, Absalon! Je ne l'ai pas trouvé alors par dépit j'ai choisi
Tandis que j'agonise.
A ce sujet, un premier coup de gueule contre les éditions
folio. Ces sombres éditeurs ont un penchant notable pour la quatrième de couverture fâcheuse. En l'occurrence,elle se contente d'être un extrait du livre. Paresse oblige, l'extrait n'a absolument rien de significatif. En sortant de la librairie avec le livre sous la poche, mis à part l'assurance que l'action se déroulait bien dans l'Amérique rurale, je ne savais rien du contenu. C'est le hasard qui a dicté mon choix, ainsi que la photographie présentée en première de couverture, une magnifique photo noir et blanc d'une famille américaine. Je pourrais aligner les lignes pour parler de cette photographie, le père de famille qui domine la verticale centrale, tranquillement adossé à une colonne de bois en train de rouler une cigarette dans sa salopette de paysan. Tout autour de lui sa famille, visiblement sa femme et ses deux filles fixent l'appareil photo. Les personnages semblent pauvres et démunis mais empreints d'une profonde majesté.
C'est malheureusement le meilleur moment du livre. L'intérieur nous présente effectivement une petite famille américaine vivant dans la misère, mais loin d'avoir cette majesté, les personnages sont présentés dans leur rusticité crasse. L'histoire nous raconte la mort d'Addie Bundren. Non, pas une mort passionnante, ni un crime à résoudre, juste la fin pathétique et morne d'une pauvre femme dans son lit, terrassée par la maladie. La seconde partie du livre se présente comme une farce de mauvais goût avec l'odyssée de la famille qui part enterrer la vieille dame. Une violente tempête à détruit les ponts pour se rendre à la ville alors les chapitres s'empilent pour nous raconter les péripéties du long chemin. Ils s'en passe des choses sur la route, des rencontres et des évènements improbables qui vont transformer l'enterrement en épopée mythique.
C'est très certainement bien écrit. Chaque chapitre nous présente le point de vue de l'un des personnages. Il paraît que c'est
Faulkner à inventé cette technique littéraire du "courant de conscience", chacun des personnages avec sa propre perception des évènements, ses préoccupations intimes. Le style d'écriture s'adapte et polymorphe il se transforme d'un chapitre à l'autre. Même si
Faulkner est l'inventeur de cette technique, force m'est de constater qu'elle a été reprise avec talent par d'autres. Que les élèves ont très largement dépassé le maitre. Là cela donne une tonalité erratique au récit, cela embrouille le lecteur et c'est surtout profondément soporifique.
Même si au cours du récit sont révélés les secrets des protagonistes, on s'ennuie ferme à la lecture. Et c'est avec soulagement que l'on accueille la dernière page.
Ouf, sauvé. Je crois que l'on ne m'y reprendra plus.

Deuxième petit livre du mois de novembre. Encore un prix Nobel, encore un détestable
folio. Il s'agit
Des souris et des hommes de
John Steinbeck. Je ne peux m'empêcher d'adresser une nouvelle malédiction aux éditeurs. Encore une fois, c'est un extrait de texte présenté dans la quatrième de couverture. Mais cette fois ci, elle révèle une scène clef de la fin du livre. Tout comme ces fâcheux qui révèlent la fin des films à suspense, avec ce genre de confidence qui gâchent le spectacle, la quatrième de couverture a véritablement ruiné ma lecture. Si les prémisses du livre auguraient la conclusion fatale et les premiers chapitres présentaient déjà les minces filaments qui retenaient la lourde épée de Damoclès, je n'en aurais jamais la certitude et ça m'exaspère. C'est d'autant plus rageant que je tient le livre pour véritablement réussi. L'impression que j'ai ressenti donc en lisant le livre c'est d'avoir la certitude du drame à venir. Comme pour un roman tragique déjà lu et relu,on sait que le malheur va s'abattre mais on espère à chaque page que cette fois-ci, ce sera différent.
Contrairement à l'ouvrage précédent, ce livre est beaucoup plus mince, même pas deux cents pages. Le style est beaucoup plus simple, plus direct. Mais surtout contrairement au style de
Faulkner, on ne pénètre jamais la conscience des personnages. La subtilité et la richesse de leurs caractères se révèle petit à petit au fil des dialogues. On apprend à connaître les protagonistes comme on le ferait dans la vrai vie, à force de les côtoyer, de leur parler, de découvrir leur vie au quotidien. Malgré leur simplicité et parfois leur grossièreté rustique, ils deviennent profondément humains et attachants. Entre le petit homme débrouillard et rusé et son ami, géant simple et naïf on pressent le drame à venir. Ils travaillent modestement, saisonniers dans les ranches, mais leurs rêves sont trop beaux pour être vrais. La dure réalité finira par les rattraper, les condamnant l'un et l'autre.
Une durable tristesse s'installe lorsque l'on termine le livre face au destin tragique des souris et des hommes. Je m'attendais à trouver une littérature engagée, à la façon
des raisins de la colère. Pas du tout. Au contraire c'est une histoire toute simple, mais le pathos la rend si belle. Un livre à lire et à relire.

On change d'univers avec le troisième livre. On quitte la misère moite des campagnes américaines pour trouver les landes froides du Devonshire et les intrigues policières de Sherlock Holmes dans l'Angleterre Victorienne. Dans cet univers feutré de luxe,
Sir Conan Doyle conte la légende du
chien des Baskerville. Je n'avais lu aucun des romans de Sherlock Holmes et pour cause il sont très peu nombreux, la plupart des aventures du détective et l'enchainement magistral de ses déductions étant plus à leur places dans des nouvelles. Il y a quelques mois j'avais lu une reprise du célèbre personnage avec l'affaire du secrétaire Italien qui m'avait passablement déçu. L'original est souvent réputé meilleur que la copie, et puis je voulais me débarrasser de ce goût amer de la trahison dans la bouche. J'ai donc investi dans ce court roman.
Ai-je trouvé mon salut avec ce livre, pas vraiment. Bien entendu on retrouve la patte de
Conan Doyle génial précurseur du roman policier. Mais on sent que l'auteur s'essouffle qu'il reprend à contrecœur son personnage pour satisfaire ses lecteurs. Et comme je le pensais, le support du roman est bien trop long pour que le lecteur soit époustouflé par l'esprit de synthèse du célèbre détective. On trouve donc un compromis étrange du roman d'aventure en suivant les pérégrinations du docteur Watson tandis que son compagnon est retenu à Londres pour d'autres affaires. Et lorsque le détective intervient, c'est pour commenter la difficulté de l'enquête. Ses déductions sont le plus souvent hasardeuses, elles ont perdu l'étincelle de génie qui les caractérisait dans mon souvenir. Ca se laisse lire, c'est même très bien écrit mais quelle amère déception de voir cette idole de mes lectures adolescente rabaissé ainsi.
Et pourtant l'intrigue était prometteuse, une malédiction ancestrale s'acharne sur la noble famille des Baskerville, un chien issu des enfers qui hante les paysages mystérieux des landes du Devonshire. Face au surnaturel, le rationnel Sherlock Holmes mène l'enquête. Sur le papier ça sonne bien, mais en pratique c'est décevant. Le mystère se dissipe en quelques pages, sans que le lecteur soit invité à affuter ses propres déductions. L'enquête se résout enfin dans une scène d'action assez déplacée. Pour une fois, ce n'est pas le cerveau qui triomphe mais les bras armés de revolver. C'est pour le moins frustrant.
Il est impératif que je retrouve les romans de mon enfances, c'est nouvelles qui m'avait passionné afin de découvrir si
Conan Doyle s'est véritablement égaré ou bien si c'est moi qui ai vieilli en embellissant un souvenir trompeur.
Hop, pour une fois je suis à jour dans mes revues de lecture. L'esprit libéré, ma cervelle d'oiseau peut enfin s'envoler vers d'autres horizons littéraires.
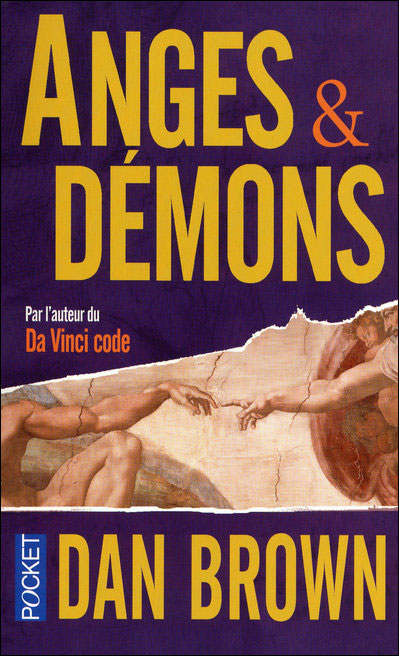 Me voilà donc à nouveau plongé dans les palpitantes aventures de Robert Langdon dans un nouveau thriller, au milieu des complots millénaires et des symboles cachés de l'histoire de l'art. Bien mal m'en a pris. Si l'on peut difficilement qualifier le Da Vinci code de chef d'œuvre, il est encore plus délicat d'attribuer à son prédécesseur la qualité de brouillon. Et pourtant, dans ce livre on sent les prémices du futur best-seller, le talent en moins.
Me voilà donc à nouveau plongé dans les palpitantes aventures de Robert Langdon dans un nouveau thriller, au milieu des complots millénaires et des symboles cachés de l'histoire de l'art. Bien mal m'en a pris. Si l'on peut difficilement qualifier le Da Vinci code de chef d'œuvre, il est encore plus délicat d'attribuer à son prédécesseur la qualité de brouillon. Et pourtant, dans ce livre on sent les prémices du futur best-seller, le talent en moins.